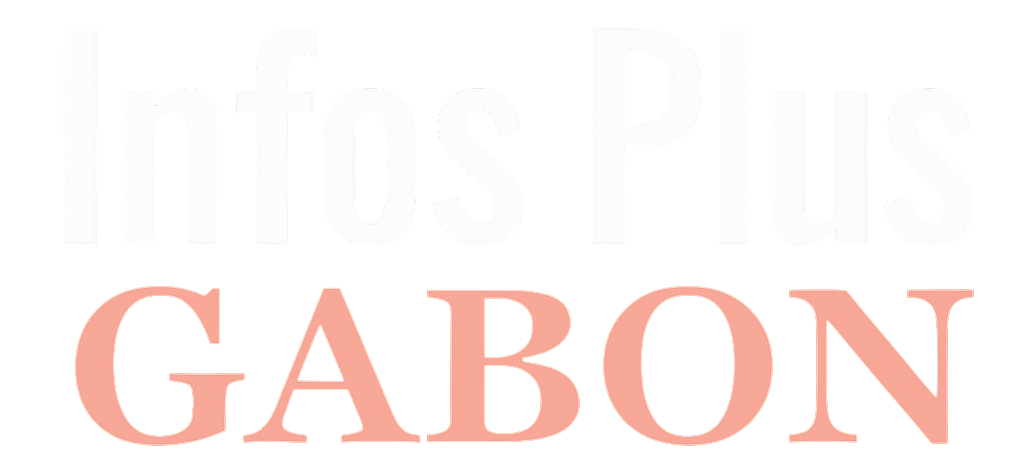LIBREVILLE, 22 octobre (Infosplusgabon) – S’il est un modèle gabonais en matière d’agriculture, parmi tant d’autres et qui émerge du lot, c’est bien la Coopérative agricole de Kayié (Coopak) dans le sud-est du Gabon où des milliers d’hectares cultivables abritent des plantations de manioc, de cacao, de café, d’igname et des arbres fruitiers à cycles longs, tous destinés à la vente sur l’étendue du pays puis à l’exportation. Objectif : contribuer à réduire les importations alimentaires qui proviennent de l’étranger.
Après avoir été délaissées pendant plusieurs décennies au profit des activités pétrolières et minières, les initiatives agricoles refont surface grâce à des initiatives privées que l’Etat se doit d’accompagner. L’optimisme qui a prévalu au lendemain de l’ajustement monétaire de 1994, avec la dévaluation du franc CFA, et qui était censé dynamiser les exportations agricoles et, donc, le secteur agricole entier, n’a pas suivi.
Quelques coopératives agricoles méticuleuses dans leurs organisations au quotidien, au nombre desquelles la Coopérative agricolede Kayié, ont opté pour des investissements industriels innovants qui leur permettraient de tenir le haut du pavé dans un secteur agricole qui recherche encore ses marques et où l’Etat gabonais « navigue » entre modèles marocain, brésilien ou encore ivoirien. Pourtant le Gabon, avec une pluviométrie favorable à l’agriculture et doté d’une importante étendue de terres cultivables, est bien condamné à réussir son agriculture s’il veut résoudre l’équation de l’autosuffisance alimentaire. Que manque-t-il alors pour relever ce défi dans un petit pays de 1,5 million d’habitants doté d’un budget toujours croissant et qui devrait atteindre, sous toutes réserves, 3 335 milliards de francs CFA en 2014 ?
L’autosuffisance alimentaire, un mirage pour le Gabon ?
Entre 1960 et 1974 le secteur agricole avait été abandonné par l’Etat. Mme Viviane Magnagna Nguema, auteur d’un ouvrage sur l’Agriculture au Gabon, rappelle l’absence à travers le pays d’une tradition d’élevage au sein des paysans dont la majorité est composée de cultivateurs, de chasseurs et de pêcheurs. Il y a également l’inexistence d’un système parallèle de commercialisation du bétail non sans oublier les conditions écologiques difficiles, souligne-t-elle. A partir de 1975, la quasi-totalité des investissements de l’Etat est allouée à l’élevage industriel des poules et des bovins : Les poules pour le projet SIAEB et les bovins pour le projet Agrogabon-Elevage, dénommé par la suite Société gabonaise d’élevage (Sogadel).
« Le manque d’aide aux éleveurs entre 1960 et 1974 a conduit, selon les terme du 3e plan quinquennal, à la stagnation de la production animalière. Par ailleurs, la production de gibiers chassés se situait à 6300 tonnes. Avec la viande d’élevage (bovins, caprins volailles, porcs) qui atteignait 900 tonnes, la production totale était limitée à 7200 tonnes, laissant un déficit en viande de 8 800 tonnes, qui ont été importées en 1974. C’est alors que des projets d’élevage industriels ont été élaborés afin de réduite les importations ». Sans succès pour le ong terme.
Le projet d’élevage industriel de poulets a connu un essor de 1977 à 2000. La Société industrielle d’agriculture et d’élevage de Boumango avait été créée en 1977 avec pour objectif la production annuelle de 2 millions de poulets au départ et une croissance de la production assez forte pour résorber les importations de poulets en provenance du Cameroun voisin d’Europe, du Brésil et du Maroc, principalement. L’Etat gabonais, avec 51% des actions, était associé à la Somdiaa qui détenait 49% des actions et qui demeurait le promoteur technique de l’opération. En outre, retardé par des difficultés de financement, le projet n’a réellement démarré qu’en 1981 grâce d’une part, aux apports en capital des Sociétés Elf Gabon (aujourd’hui Total Gabon) et de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et d’autre part, aux prêts français de la Caisse centrale de coopération et du Fonds européen de développement (FED).
L’investissement, estimé à 4 milliards de francs CFA, était en effet élevé. Il comprenait les frais de création du complexe dans la région des savanes désertes de la province du Haut-Ogooué, près de Franceville, le défrichement de 2500 hectares de terre et leur aménagement, un gros matériel de culture, les poulaillers et les installations pour le conditionnement et la conservation. Par ailleurs, le complexe était hautement mécanisé. Entreprise intégrée, la SIAEB produisait également les aliments pour ses volailles, maïs, riz et soja. Entrée en production à la fin 1982, elle a livré 2 900 tonnes de poulets à partir de 1985. Puis comme toute exploitation agricole formelle, elle a été confrontée à de sérieux blocages au niveau de la production et de la commercialisation. Aussi, est-il nécessaire d’observer une filière avant et après la dévaluation du franc CFA.
L’espoir renait avec la Coopérative agricole de Kayié
C’est à un peu plus d’une heure trente de Bongoville, dans une région sablonneuse aux horizons lointains que des villageois ont choisi, loin des discours politiques, de mener à bien un projet agricole d’une dimension futuriste mais palpable pour jouer à fond la carte de l’autonomie alimentaire pour leur pays. Après une longue course d’exploitations agricoles villageoises, ici et là, nous avons découvert, loin des centres urbains une coopérative en peline expansion qui possède le site le mieux approprié au développement de l’agriculture intensive au Gabon. Il n’en demeure pas moins que le pays importe plus de 300 milliards de F CFA en produits alimentaires/an alors que localement, la production alimentaire est réalisable à travers les 9 régions du pays.
Pour assurer au Gabon une autonomisation et une sécurité alimentaire au cours des prochaines années, l’Etat gabonais et les industries gabonaises, déjà en orbite dans le secteur agro-alimentaire, devraient unir leurs efforts pour réduire de manière significative les importations des aliments. En partenariat avec les opérateurs privés, le Gabon ambitionnerait d’investir 17 000 milliards de francs CFA d’ici 2025. Pendant ce temps, sur le terrain, des coopératives recherchent en vain des financements pour atteindre leur meilleur rendement de production.
Bien avant que les orientations du gouvernement destinées à soutenir et à développer la politique industrielle ne prennent forme, quelques coopératives agricoles qu’on pourrait qualifier de « précurseurs » avaient déjà mobilisé leurs énergies avec pour objectifs la diversification économique et les investissements adaptés.
Côté gouvernemental, un projet conventionné à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA à travers un accord avec la société israélienne Mori Investments porte déjà ses premiers fruits. Mais qu’en est-il pour les exploitations gabonaises qui aspirent à une agriculture dynamique et source de nombreux emplois ? Concourant au développement socioéconomique local, le développement agricole national et ses activités satellites s’inscrivent dans le cadre plus vaste de la lutte contre la vie chère où de nombreuses mesures, plutôt timides, furent prises pour soulager le panier de la ménagère.
Pour 2014, l’objectif est l’adoption par le gouvernement d’un programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Gageons que la Coopak et d’autres regroupements de cultivateurs ou villageois méritants ne seront pas laissés pour compte.
FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/ GABON 2013
© Copyright Infosplusgabon