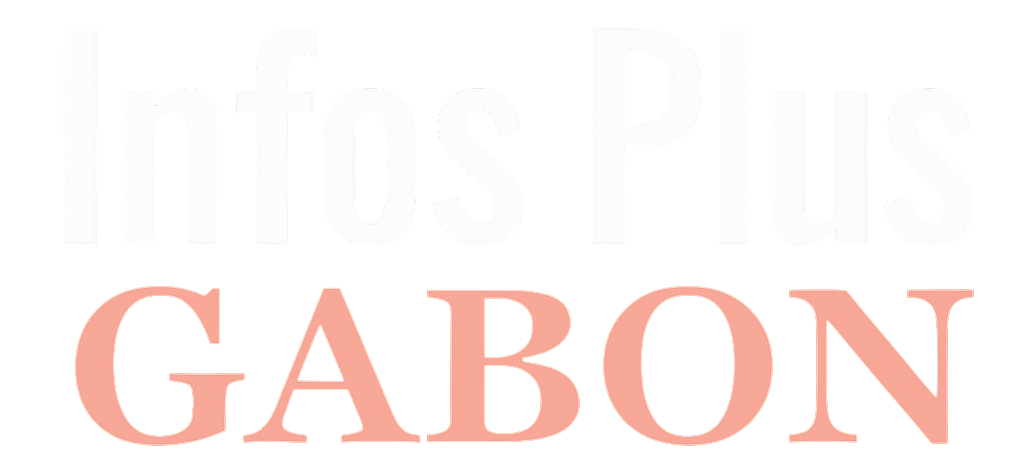Nairobi, Kenya, 3 avril (Infosplusgabon) – Les manifestants de toute l’Afrique subsaharienne ont bravé les balles et les coups pour défendre leurs droits face à la poursuite des conflits et de la répression étatique, a déclaré Amnesty International le jeudi 8 novembre dans son rapport annuel sur les droits de l’homme dans la région.
L’organisation humanitaire a souligné le courage et le défi des personnes qui ont envahi la rue pour exiger des changements, mais a averti qu’elles étaient laissées pour compte par les gouvernements qui continuent à commettre des violations des droits humains.
Le rapport analyse les principaux développements de l’année écoulée, notamment le renversement du président soudanais Omar al-Bashir, la réponse du gouvernement zimbabwéen aux protestations de masse et les attaques croissantes contre les civils au Mozambique et au Mali.
L’Afrique a été témoin en 2019, d’un pouvoir populaire incroyable lors des manifestations de masse qui ont balayé l’Afrique subsaharienne. Ces manifestations ont eu lieu au Soudan, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo et en Guinée, où les gens ont bravé des mesures de répression brutales pour défendre leurs droits.
Deprose Muchena, directrice du programme Afrique orientale et australe d’Amnesty International, a déclaré que dans certains cas, les protestations avaient entraîné des changements majeurs.
« Après le renversement du leader de longue date du Soudan, Omar al-Bashir, les nouvelles autorités ont promis des réformes favorables aux droits de l’homme et, suite aux protestations, un train de réformes a été introduit par le gouvernement éthiopien.
« Malheureusement, d’autres changements nécessaires sont bloqués par des gouvernements répressifs, qui continuent à commettre des violations en toute impunité », a déclaré M. Muchena.
Dans toute l’Afrique subsaharienne, les civils sont les plus touchés par les conflits meurtriers et les crises violentes.
Dans la région soudanaise du Darfour, les forces gouvernementales ont continué à commettre d’éventuels crimes de guerre entre autres violations graves des droits de l’homme, notamment des assassinats illégaux, une violence sexuelle, des pillages systématiques et des déplacements forcés.
En RDC, des dizaines de groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les forces de sécurité du pays, ont continué à commettre des violations des droits de l’homme qui ont fait plus de 2.000 morts parmi les civils et au moins un million de personnes ont été déplacées de force au cours de l’année 2019.
En Somalie, les civils ont continué à vivre avec les attaques du groupe armé Al-Shabaab laissées à elles-mêmes par le gouvernement et les forces internationales alliées qui n’ont pas pris de précautions suffisantes pour épargner aux civils leurs attaques visant Al-Shabaab.
Des groupes armés ont mené des attaques contre des civils au Cameroun, en République centrafricaine et au Burkina Faso, tandis que les gouvernements n’ont pas protégé les civils. La sécurité s’est considérablement détériorée dans le centre du Mali, avec de nombreux meurtres de civils par des groupes armés et des « groupes d’autodéfense » autoproclamés.
En réaction, les forces de sécurité maliennes ont commis de multiples violations, notamment des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture.
Au Mozambique, les groupes armés ont continué à mener des attaques contre la population à Cabo Delgado, et les forces de sécurité auraient commis de graves violations des droits de l’homme dans leur réponse à la violence.
En Éthiopie, les affrontements entre les communautés ethniques ont suscité une réaction disproportionnée de la part des forces de sécurité. Dans les régions anglophones du Cameroun, des groupes séparatistes armés ont continué à commettre des abus, notamment des meurtres, des mutilations et des enlèvements. Plusieurs établissements de santé ont également été détruits par des séparatistes armés. En réponse, les militaires ont commis des exécutions extrajudiciaires et incendié des maisons.
« L’accès aux soins de santé reste une préoccupation majeure pour la population de toute la région, l’insuffisance de financement des budgets de santé entraînant une pénurie de lits et de médicaments dans les hôpitaux. De l’Angola au Zimbabwe, du Burundi au Cameroun, les gouvernements n’ont pas respecté le droit à la santé, et les conflits ont aggravé la situation », a déclaré Samira Daoud, directrice régionale du programme Afrique de l’Ouest et centrale d’Amnesty International.
« Avec la pandémie de la COVID-19 qui se profile à l’horizon, il n’y a pas de temps à perdre pour s’attaquer aux inégalités et aux violations des droits humains qui rendent les soins de santé inaccessibles à tant de personnes ».
Dans toute la région, les défenseurs des droits de l’homme ont été persécutés et harcelés pour s’être élevés contre les gouvernements. Le Burundi, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, la Zambie et la Guinée équatoriale ont tous connu une vague de répression de l’activisme en 2019.
Au Malawi, des militants qui ont organisé et dirigé des manifestations contre la présumée fraude électorale après les élections de mai ont été attaqués et intimidés par des cadres de la jeunesse du parti au pouvoir et ont fait l’objet de poursuites de la part des autorités. Le vote a ensuite été annulé par les tribunaux et le pays se prépare à organiser d’autres élections plus tard dans l’année.
Au Zimbabwe, au moins 22 défenseurs des droits de l’homme, activistes, membres de la société civile et dirigeants de l’opposition ont été inculpés pour leur présumé rôle dans l’organisation de manifestations contre la hausse des prix du carburant de janvier 2019. Les forces de sécurité ont déclenché une violente répression, tuant au moins 15 personnes et en blessant des dizaines d’autres.
En Guinée, où les autorités ont interdit plus de 20 manifestations pour des motifs vagues et trop flous, les forces de sécurité ont continué à alimenter la violence pendant les manifestations et au moins 17 personnes ont été tuées l’année dernière.
Dans 17 pays d’Afrique subsaharienne, des journalistes ont été arbitrairement arrêtés et détenus en 2019. Au Nigeria, par exemple, 19 cas d’agression, d’arrestation arbitraire et de détention de journalistes ont été enregistrés, dont beaucoup ont été accusés sur de fausses bases. Au Burundi, les autorités ont continué à réprimer le travail des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile, notamment en les soumettant à des poursuites et à de longues peines d’emprisonnement.
Les violations persistantes des droits de l’homme ont forcé des centaines de milliers de personnes dans la région à fuir leurs foyers en quête de protection. La République centrafricaine compte environ 600.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, le Tchad plus de 222.000 et le Burkina Faso plus d’un demi-million.
En Afrique du Sud, la violence xénophobe systématique et meurtrière s’est poursuivie à l’encontre des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, en partie en raison de l’impunité dont ont bénéficié pendant des années les auteurs d’attaques passées et des échecs de la justice pénale. Douze personnes, dont des Sud-Africains et des étrangers, ont été tuées après le déclenchement de la violence entre août et septembre.
Malgré ce sombre contexte, quelques victoires notables dans le domaine des droits de l’homme ont été obtenues l’année dernière. Les manifestations de masse au Soudan ont mis fin au régime répressif d’Al-Bachir en avril 2019 et les nouvelles autorités ont promis des réformes de grande envergure pour améliorer l’exercice des droits de l’homme.
Le gouvernement éthiopien a annulé la loi sur la société civile qui avait restreint le droit aux libertés d’association et d’expression et a présenté une nouvelle loi devant le Parlement pour remplacer la législation anti-terroriste draconienne. En RDC, les autorités ont annoncé la libération de 700 prisonniers, dont plusieurs prisonniers d’opinion. Des victoires ont également été remportées par des individus.
En Mauritanie, le blogueur et prisonnier d’opinion Mohamed Mkhaïtir a été libéré après plus de cinq ans de détention arbitraire. Bien que l’impunité pour les violations des droits de l’homme se soit largement maintenue, il y a eu quelques petits pas en avant en 2019.
Il y a eu une lueur d’espoir pour le peuple somalien lorsque le Commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM) a admis pour la première fois en avril 2019 avoir tué des civils lors de frappes aériennes visant Al Shabaab, ouvrant ainsi la porte à des réparations pour les victimes. Des progrès ont également été réalisés dans les tribunaux ordinaires de la RCA qui examinent certains cas d’abus commis par des groupes armés.
Le Tribunal pénal spécial a reçu 27 plaintes et a commencé des enquêtes l’année dernière.
« Des militants et des jeunes ont défié leurs gouvernements en 2019 ».
« En 2020, les dirigeants doivent écouter leurs demandes et travailler à des réformes urgentes qui respectent les droits de chacun », a déclaré Samira Daoud.
FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon